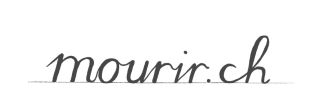Critique du concept de la mort cérébrale
Malaise face au concept
Par Sabine Arnold
Les personnes victimes d’une mort cérébrale ne donnent pas l’impression d’être mortes et ne le sont pas corporellement. Voilà pourquoi nombreux sont ceux qui remettent en cause le concept de « mort cérébrale ».
La critique du concept s’effectue sur plusieurs plans. En principe il faut d’abord remettre en question la « centralité du cerveau », cette vision de l’être humain qui définit la vie humaine par le cerveau. Christian Schopper, anthroposophe autrefois actif en tant que neurologue au service de réanimation de l’hôpital universitaire de Zürich, évoquait lors d’une conférence le neurochirurgien Eben Alexander, dont l’expérience de mort imminente était devenue célèbre et dont le livre contenait l’affirmation : « Les équations "cerveau égale âme", "fonction cérébrale égale fonction animique", "mort cérébrale égale mort totale" ne sont pas admissibles » [i]. Schopper écrit à un autre endroit que lorsqu’on demande à une personne : « Où est ton âme ? » ou bien « Qui es-tu ? », celle-ci porte sa main à son cœur et non à sa tête.
Le second aspect de la critique est que les personnes considérées comme cérébralement mortes ne semblent pas gagnées par la mort et n’en ont pas le comportement. Leur corps est encore chaud. Elles peuvent guérir leurs blessures. Elles digèrent et grandissent. Les réflexes fonctionnent encore. On connaît même le cas de femmes qui dans cet état ont mis au monde des nourrissons sains.
Sur la page web de l’association de citoyens et de patients dite Gesundheit Aktiv, on pouvait lire : « La mort du cerveau représente seulement 3% du corps, les 97% restants fonctionnent encore. » Alan Shewmon, neurologue et pédiatre à Los Angeles, l’un des critiques les plus importants du concept de mort cérébrale, a pu prouver cela dans une étude remarquable : il a évalué plus de 12500 situations documentées de mort cérébrale. Parmi elles, 175 cas ont pu vivre plus d’une semaine en étant placés sous assistance respiratoire suffisante. 56 cas ont pu être analysés encore plus précisément grâce à une bonne base de données : « Dans l’ensemble, on a constaté chez ces patients des développements étonnants dans le rétablissement des fonctions corporelles normales ou dans la guérison de maladies. Ils ont nécessité en partie des soins si réduits que ceux à domicile ont suffi » [ii].
Exclusion des questions d’ordre spirituel
Comme mentionné plus haut, les églises chrétiennes approuvent certes le concept de mort corporelle, mais excluent les questions d’ordre spirituel qui, dans le domaine des dons d’organes, paraissent importantes à nombre de gens : quand on passe de la vie à la mort, que se passe-t-il avec la conscience, l’âme et l’esprit ? Est-ce que le don d’organes influence ce passage ? Est-ce que quelque chose du donneur demeure dans l’organe ?
Pour trouver des réponses à cela, la possibilité s’offre d’analyser le concept de mort cérébrale selon le point de vue anthroposophique.
[i] Schopper, Christian: Coma vigile, mort cérébrale et transplantation d’organes. Cahier anthrosana, 2014, de l’association pour une médecine élargie par l’anthroposophie, anthrosana.
[ii] Edelhäuser, Friedrich: Person und Bewusstsein im «Hirntod» – Konzept aus neurologischer Perspektive. Dans: Der Merkurstab. Revue de médecine anthroposophique. 2014, Cahier 5, pages 349-361.